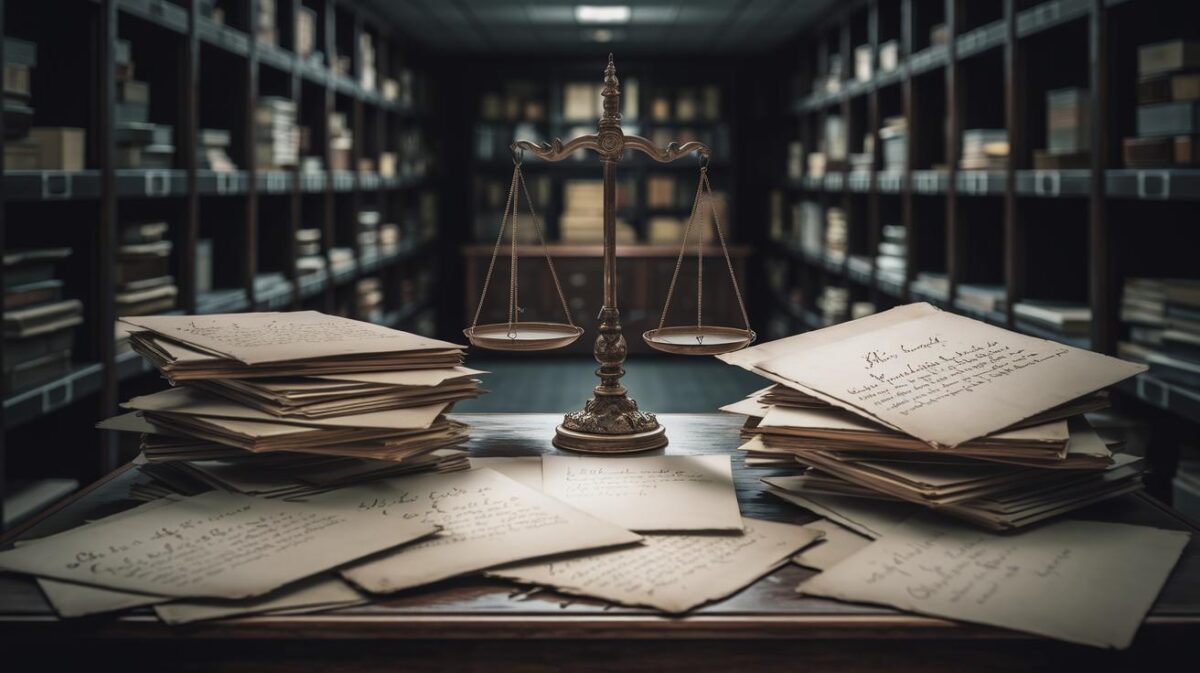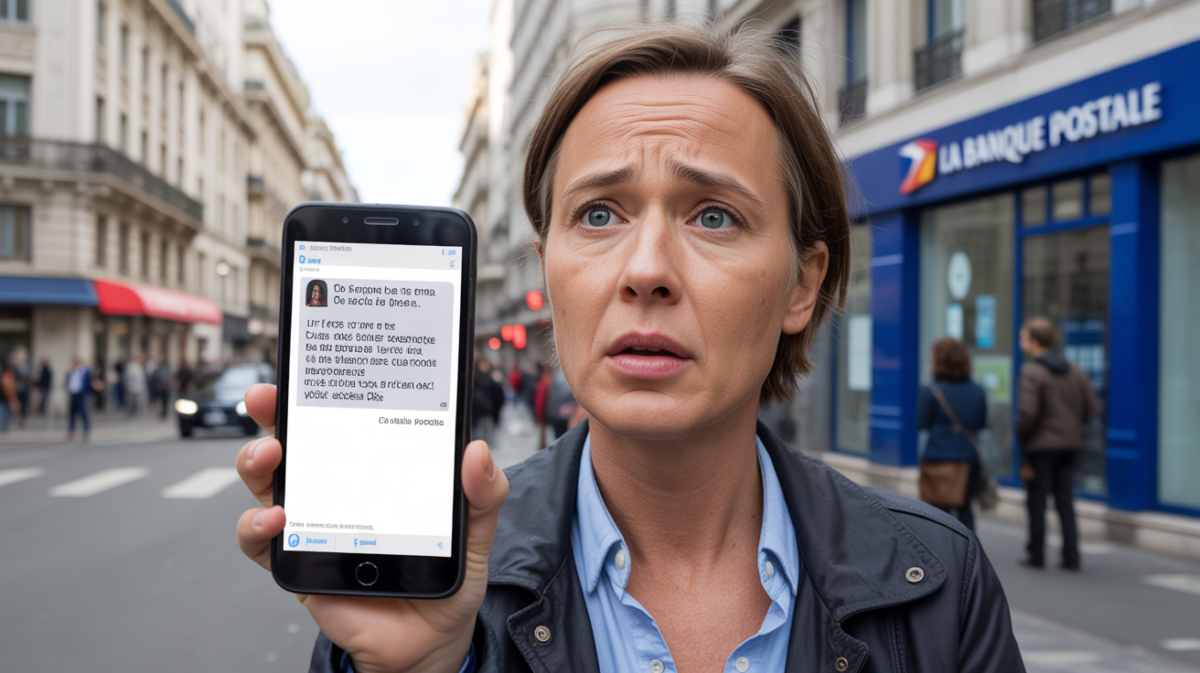Dans cet article Dans cet article
- Un greffier discret devenu faussaire prolifique
- L’académicien piégé par l’authenticité supposée
- L’arrestation et le procès
- Comment fonctionne une telle sanction ? Mode d’emploi judiciaire
- Les faux les plus extravagants
- D’autres affaires comparables ? Pas vraiment… mais presque
- L’héritage insolite : quand Dreux érige une statue avec un faux document
- Peines et conséquences pratiques pour les protagonistes
En février 1870, un ancien greffier de Châteaudun est condamné à deux ans de prison pour avoir produit… pas moins de 27 000 faux autographes d’illustres personnages historiques.
Tout commence par une série de courriers surgis du passé : Pascal, Newton, Galilée, Jeanne d’Arc, Jules César et même Cléopâtre prennent mystérieusement la plume. J’ai retrouvé dans les archives judiciaires le récit presque théâtral d’une escroquerie qui fit chanceler savants et magistrats.
Un greffier discret devenu faussaire prolifique
Denis Vrain Lucas, né en 1818 à Châteaudun, mène d’abord une carrière modeste comme assistant chez un avoué puis greffier expéditionnaire au tribunal local. Mais derrière son bureau s’éveille une passion dévorante pour les vieux manuscrits. Il lit compulsivement dans les bibliothèques municipales et s’imprègne des tournures anciennes. De quoi se forger une solide compétence… en contrefaçon.
Sous sa plume naissent des centaines de pages où l’Histoire se réécrit : Jeanne d’Arc écrit à ses parents comme si elle tenait un journal intime moderne, Newton remercie Pascal alors qu’il n’a que onze ans, César détaille ses plans militaires en français impeccable. Les anachronismes n’effraient pas l’artisan : on compte en tout près de 27 000 documents fabriqués entre 1861 et 1869.
L’académicien piégé par l’authenticité supposée
La victime principale n’est autre que Michel Chasles, mathématicien réputé et membre de l’Institut. Convaincu de posséder des preuves bouleversant l’histoire des sciences, il présente ces « trésors » devant ses pairs. Chaque objection entraîne aussitôt la production d’un nouveau lot providentiel signé Descartes, Galilée ou Leibniz. La communauté scientifique britannique finit par dénoncer la supercherie.
Lorsque la presse s’en empare en 1867, c’est déjà trop tard : Chasles a payé environ 150 000 francs-or pour cette collection imaginaire. Une somme colossale à l’époque — équivalente à plusieurs millions d’euros actuels selon les estimations économiques.
L’arrestation et le procès
En 1869, mis devant ses contradictions, Chasles finit par livrer le nom de son fournisseur : Denis Vrain Lucas. L’ancien greffier est arrêté sur ordre du parquet de Paris et rapidement placé en détention préventive. Devant le tribunal correctionnel de la Seine, il reconnaît les faits sans détour.
Le jugement tombe le 24 février 1870 : deux ans d’emprisonnement et 500 francs d’amende pour escroquerie et abus de confiance. À titre de comparaison, selon les statistiques judiciaires contemporaines disponibles aux Archives nationales, plus de la moitié des condamnations correctionnelles de l’époque n’excédaient pas six mois fermes — ce qui souligne la sévérité relative du verdict.
Comment fonctionne une telle sanction ? Mode d’emploi judiciaire
L’escroquerie est prévue à l’époque par le Code pénal comme un délit passible jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. La peine prononcée dépend :
- de l’ampleur du préjudice financier causé aux victimes ;
- de la préméditation manifeste des actes ;
- du rôle joué par la tromperie dans les relations contractuelles ;
- de la personnalité du prévenu et de son casier judiciaire.
L’appel pouvait être formé dans un délai légal de trois jours après signification du jugement — délai jugé extrêmement bref par rapport aux standards actuels (dix jours minimum aujourd’hui). Les alternatives prévues étaient rares avant la réforme pénitentiaire du XXe siècle : pas question encore de bracelet électronique ni de travail d’intérêt général.
Les faux les plus extravagants
Parmi les milliers de documents inventés par Vrain Lucas figurent quelques pièces dignes d’un roman :
| Auteur supposé | Destinataire | Sujet évoqué |
|---|---|---|
| Jules César | Vercingétorix | Avertissement avant l’invasion des Gaules |
| Cléopâtre | César | L’air marin de Marseille et ses écoles modernes |
| Jeanne d’Arc | Ses parents | Banalités domestiques signées « comme Cléopâtre » |
| Alexandre le Grand | Aristote | Invitation à découvrir la science druidique gauloise |
| Marie-Madeleine | Anonymes gaulois | L’affirmation que les sciences viennent… des Gaulois eux-mêmes |
D’autres affaires comparables ? Pas vraiment… mais presque
L’affaire Vrain Lucas reste exceptionnelle par son ampleur numérique : aucun autre faussaire connu n’a produit autant de documents contrefaits en si peu d’années. Pour comparaison récente, selon le rapport annuel du ministère de la Justice (données publiques), on dénombre aujourd’hui environ 3 500 condamnations annuelles pour faux et usage de faux en France — mais elles concernent majoritairement chèques ou papiers administratifs.
L’affaire rappelle néanmoins certains scandales littéraires du XXe siècle autour des faux manuscrits attribués à Rimbaud ou Apollinaire. Dans ces cas modernes, quelques dizaines de pages suffisent à déclencher expertises interminables et polémiques muséales ; ici nous parlons non pas de dizaines mais bien de dizaines de milliers.
L’héritage insolite : quand Dreux érige une statue avec un faux document
L’écho judiciaire ne s’arrête pas au procès. À Dreux, une statue érigée en hommage au dramaturge Jean Rotrou porte encore sur son socle le texte… d’une lettre supposément authentique offerte par Chasles à la ville — mais qui fut écrite par Vrain Lucas lui-même. Le faux monumental est donc gravé dans la pierre depuis plus d’un siècle sans rectification officielle.
Peines et conséquences pratiques pour les protagonistes
Pendant ses deux années derrière les barreaux, Vrain Lucas ne produira évidemment plus aucun manuscrit apocryphe — encore qu’on raconte qu’il esquissa quelques projets clandestins sur papier brouillon fourni par ses surveillants. Après sa libération, il disparaît presque totalement des radars judiciaires.
Aujourd’hui encore, certaines bibliothèques conservent précieusement ces faux comme témoignages historiques autant que pièces judiciaires. Leur valeur marchande est paradoxalement devenue réelle : non pas pour leur contenu inventé mais pour ce qu’ils disent sur la crédulité savante et sur la capacité du droit pénal à encadrer l’imagination débridée d’un ancien greffier provincial.