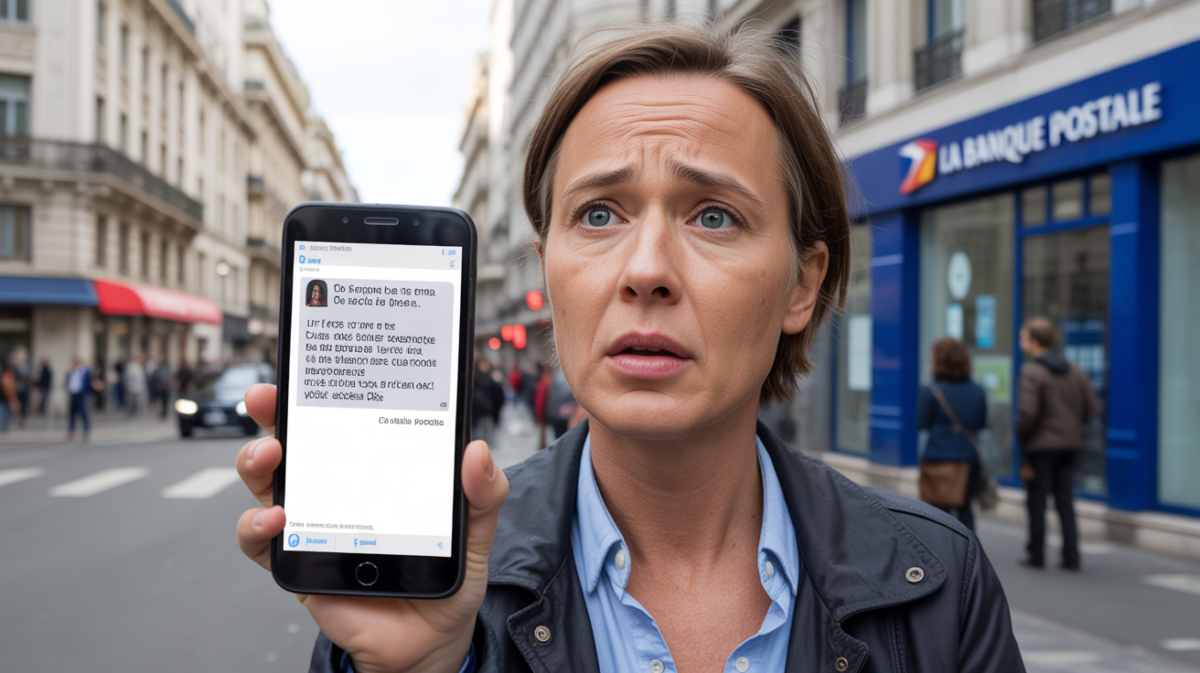Dans cet article Dans cet article
Les routes du désert du Néguev ont accueilli un véhicule capable de rouler presque indéfiniment sans batterie, ni essence. Rien de futuriste : tout est là, aujourd’hui. Un véhicule modifié, une route équipée, et une promesse d’autonomie permanente. Pourtant, vous n’en avez sans doute jamais entendu parler. Et ce n’est pas un hasard.
Un test grandeur nature loin des projecteurs
C’est en Israël, dans un coin reculé du territoire entre Be’er Sheva et Lahavim, qu’Electreon, une start-up spécialisée dans la recharge par induction sans fil, a mis en place une section de route électrifiée capable d’alimenter des véhicules adaptés directement pendant leur trajet. Le principe est simple mais efficace : des bobines enfouies sous la chaussée transmettent de l’énergie à des récepteurs positionnés sous les véhicules, sans contact ni arrêt nécessaire.
Le résultat a surpris même les ingénieurs impliqués dans le test : un véhicule électrique a pu parcourir 1 942 kilomètres… sans s’arrêter pour une seule recharge, et sans embarquer de batterie classique. À la place, un micro-capaciteur assurait une alimentation transitoire de quelques secondes — largement suffisante grâce à l’alimentation continue par le sol.
“Cette technologie qui ne marche ni à batterie, ni à essence…”
« C’est une absurdité totale de continuer à faire des voitures qui passent plus de 90 % de leur vie à l’arrêt pour recharger ou attendre une station » me confie Ifat Cohen, ingénieure en électromobilité et ex-responsable projet chez un groupe européen de premier plan. « Ce système fonctionne et il est déjà prêt pour les transports en commun urbains. Mais personne ne veut bouger. »
En effet, la démonstration d’Electreon ne s’est pas faite dans un laboratoire, mais sur une route publique, largement conforme aux standards de voirie urbaine. C’est la preuve que l’infrastructure est adaptable. Le système a délivré 231 kWh pendant le test : une performance technique, mais aussi une provocation adressée au modèle énergétique établi.
Pourquoi les industriels gardent le silence
Les industriels de l’automobile et de l’énergie n’ignorent pas cette technologie. Elle est connue, documentée, et même régulièrement présentée dans les salons technologiques. Mais aucun constructeur majeur ne l’a intégrée dans un plan d’investissement à grande échelle. Un responsable d’un constructeur allemand, sous couvert d’anonymat, résume la réalité :
« Ce genre d’innovation n’est pas rentable dans le cycle de vie actuel des véhicules. Plus un véhicule coûte en maintenance, en pièces, en batteries à remplacer, plus cela alimente l’économie dite ‘après-vente’. L’induction, c’est la fin de tout ça. »
Un aveu brut qui éclaire un angle mort de l’écosystème automobile : tout changement structurel entraîne une redistribution économique. Ce ne sont pas seulement les constructeurs qui freinent ; les sous-traitants, les distributeurs d’énergie ou les opérateurs de mobilité y perdraient aussi beaucoup.
Les limites assumées mais contournables
Ce système a-t-il des faiblesses ? Oui. Aujourd’hui, il est encore coûteux à déployer, demande une modernisation totale de l’infrastructure routière, et impose de nouveaux standards techniques pour les véhicules. Mais les États investissent déjà massivement dans des réseaux électriques pour alimenter les bornes de recharge ; pourquoi ne pas poser directement des bobines sous le bitume ?
Voici les principales contraintes techniques :
- Coût d’installation actuel : entre 1 M€ et 2 M€ par kilomètre
- Compatibilité nécessaire avec les véhicules spécifiques, équipés de captateurs adaptés
- Rendement énergétique encore à optimiser (autour de 80 % actuellement)
Malgré tout, ces chiffres sont comparables aux programmes de modernisation de voirie ou de déploiement de télécoms par fibre optique massivement subventionnés. À terme, une mutualisation pourrait réduire ces coûts de moitié.
Une vision piégée entre batteries et combustion
Depuis une décennie, le débat automobile s’est structuré autour d’un faux dilemme : batterie ou carburant ? Pendant ce temps, des solutions alternatives peinent à exister. L’hydrogène, par exemple, reste marginal dans les ventes ; la recharge par induction stationnaire est cantonnée aux flottes captives comme les tramways. Et l’induction dynamique, comme celle d’Electreon, reste quasi invisible dans les politiques publiques.
Un comparatif illustre cette dichotomie :
| Type de motorisation | Type d’énergie | Autonomie | Temps de recharge/ravitaillement | Émissions directes |
|---|---|---|---|---|
| Thermique | Essence/Diesel | 600-800 km | 5 min | Élevées |
| Électrique | Batterie lithium-ion | 300-500 km | 30 à 60 min | Nulles (directement) |
| Induction dynamique | Alimentation au sol | Illimitée sur parcours équipé | Inutile (recharge continue) | Nulles |
Le risque d’un progrès contenu
La technologie d’induction dynamique pourrait bouleverser tout un secteur. Mais elle suppose une rupture dans le modèle économique qui alimente les revenus récurrents de nombreuses industries. Il ne faut pas chercher un complot, mais une inertie. Celle des habitudes, des intérêts, et de l’infrastructure construite sur un système datant du 20e siècle.
Il devient difficile d’ignorer que ce “silence” apparent est en réalité le reflet d’un consensus industriel autour d’un statu quo profitable. Au fond, le progrès technologique n’est pas toujours une question de faisabilité, mais de volonté de transformation. Et pour l’instant, cette volonté manque cruellement.