Dans cet article Dans cet article
- Ce que dit la loi : un principe général strict
- Les méthodes discrètes utilisées par certains employeurs
- Les droits réels des salariés
- Repérer les clauses favorables dans son contrat ou sa convention
- Obtenir gain de cause en cas de litige
- Un enjeu financier sous-estimé
- Conclusion : vigilance et information, vos meilleurs alliés
Le temps de transport entre le domicile et le lieu de travail suscite régulièrement des interrogations quant à sa rémunération. Bien que le Code du travail établisse un cadre clair, certaines pratiques d’entreprises tendent à contourner les droits des salariés. Pourtant, ceux-ci disposent de leviers concrets pour faire valoir leurs droits.
Ce que dit la loi : un principe général strict
Selon l’article L3121-4 du Code du travail, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail – qu’il s’agisse du siège, d’un bureau ou d’un chantier – ne constitue pas un temps de travail effectif. Par conséquent, il ne donne pas lieu à rémunération.
Ce principe s’applique à l’ensemble des salariés sous contrat, sans distinction de catégorie. Il pose une norme, mais plusieurs exceptions et pratiques contournent ou ajustent cette règle dans les faits.
Les méthodes discrètes utilisées par certains employeurs
Plusieurs techniques permettent à certaines entreprises d’éviter la rémunération de trajets qui, dans des contextes précis, pourraient relever du temps de travail effectif.
Autonomie apparente du salarié itinérant
Chez les salariés itinérants (techniciens, commerciaux, livreurs), les déplacements sont nécessaires à l’activité. Pourtant, pour éviter toute obligation, certains employeurs mettent en place les dispositifs suivants :
- Installation de dispositifs de géolocalisation avec bouton « vie privée », permettant de considérer que le salarié n’est pas sous le contrôle de l’employeur pendant le trajet
- Liberté de choisir l’itinéraire ou les arrêts, interprétée comme une autonomie incompatible avec un temps de travail effectif
- Suivi rétrospectif des trajets, ce qui diminue la preuve d’un encadrement en temps réel
- Sélection libre des « soirées étapes », parfois considérée comme une gestion personnelle du planning
Ces pratiques visent à établir que le salarié n’est pas « à la disposition de l’employeur », critère essentiel pour que le temps soit reconnu comme travaillé (source CFDT).
La fiction du partage des trajets dans le BTP
Dans le bâtiment et les travaux publics, une idée largement répandue voudrait que le trajet matin soit à la charge de l’ouvrier, le soir à celle de l’employeur. Or, ni la loi ni la jurisprudence ne reconnaissent cette fiction.
L’ensemble du déplacement professionnel imposé – y compris les trajets en camionnette vers un chantier – constitue un engagement à disposition de l’entreprise. Dans ce cadre, l’entreprise a l’obligation d’organiser et financer les transports, sans en transférer la responsabilité au salarié (source CAPEB).
Les droits réels des salariés
Malgré les stratégies d’évitement, plusieurs situations obligent légalement l’employeur à compenser le temps de transport.
Salariés itinérants
Le rapport à la mobilité est différent pour les profils itinérants. Le déplacement vers un client, dès lors qu’il est demandé dans la mission, s’inscrit dans le temps de travail. Cette reconnaissance a été confirmée par la Cour de cassation et plusieurs juridictions européennes (source Lodievo).
Déplacements exceptionnels hors lieu habituel
Si l’employeur vous affecte exceptionnellement à un autre site, les temps de trajet occasionnés doivent donner lieu à une compensation en temps ou en argent. Cela peut être précisé par accord d’entreprise ou convention de branche.
Conventions collectives plus favorables
De nombreuses branches comme le transport, la propreté ou la sécurité, imposent la rémunération des temps de trajet. Il est indispensable de lire votre convention collective pour vérifier vos droits spécifiques.
Repérer les clauses favorables dans son contrat ou sa convention
Certains contrats de travail comportent une clause précisant les modalités de prise en charge des déplacements. De même, les conventions collectives mentionnent fréquemment :
| Secteur | Règle sur les trajets |
|---|---|
| Sécurité privée | Temps rémunéré dès le départ du local d’entreprise |
| Propreté | Indemnité obligatoire après un certain nombre de kilomètres |
| Transport | Trajet intégré dans le planning |
Obtenir gain de cause en cas de litige
Si vous constatez un manquement, plusieurs étapes peuvent être entreprises :
- Faire une demande écrite à son supérieur ou à la direction RH
- Contacter un élu du personnel ou un délégué syndical pour relayer la question
- Conserver des preuves : relevés GPS, e-mails, captures d’écran d’outils professionnels, etc.
- Saisir le conseil de prud’hommes en cas de refus manifeste
Un enjeu financier sous-estimé
Selon une étude IFOP–Alphabet, le temps moyen quotidien passé dans les transports par les travailleurs français est de 48 minutes aller-retour. Sur une base de 220 jours travaillés par an, cela représente environ 176 heures de trajet non rémunérées.
Sur un Smic horaire proche de 11 euros, cela équivaut à plus de 1 900 euros annuels en équivalent temps non payé. Une donnée non négligeable pour beaucoup de foyers. Selon une étude citée par Morgan Philips, les salariés sont prêts à changer d’emploi pour un gain de 50 euros mensuels, mettant en exergue l’impact budgétaire des temps de trajet sur la décision professionnelle.
Conclusion : vigilance et information, vos meilleurs alliés
La non-rémunération automatique des temps de transport entre domicile et travail repose sur un principe légal. Mais des exceptions précises – liées au type d’emploi, aux déplacements professionnels, et aux accords collectifs – peuvent renverser cette logique.
Décrypter les mécanismes d’évitement employés dans certains secteurs, et surtout connaître vos droits conventionnels, vous permet de mieux défendre vos intérêts. Le temps est un enjeu salarial aussi stratégique que le salaire de base ou les primes annexes.

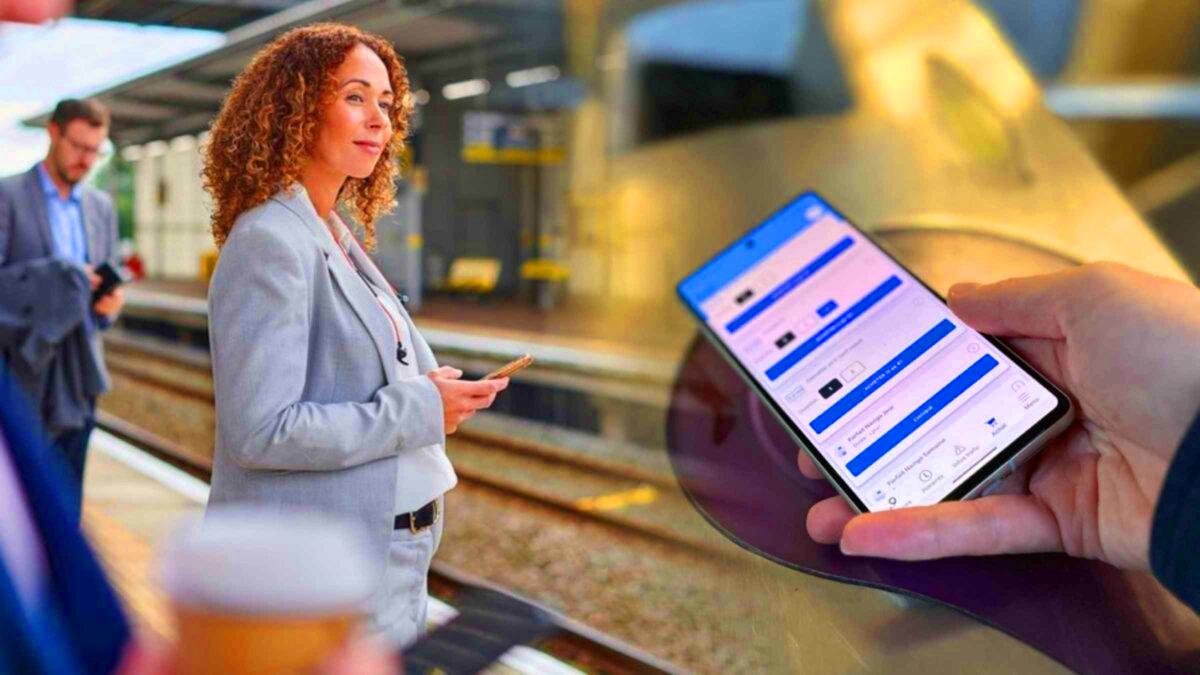


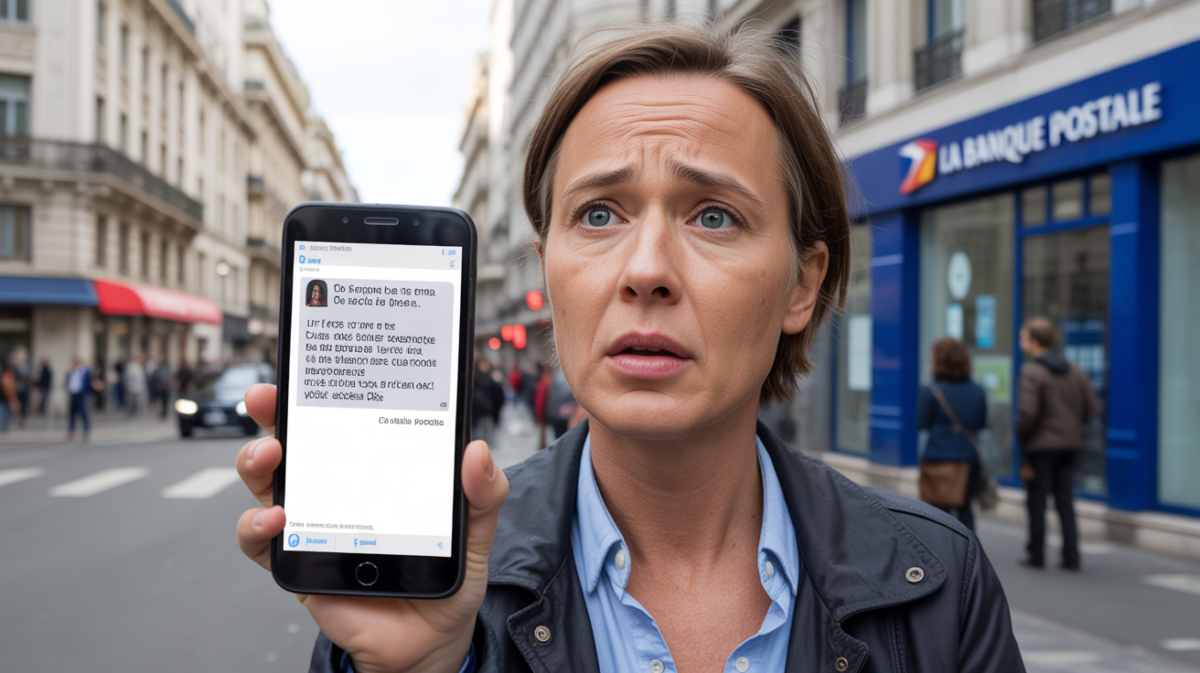

Trop souvent les gens acceptent sans contester, alors qu’ils ont des droits. Merci d’avoir rappelé ça ! 🙂
Question naïve : si je télétravaille deux jours par semaine, je gagne combien en temps non payé économisé ? ^^
Courage à tous ceux qui font 2h de RER par jour sans être payés… respect 👏
J’aime bien la conclusion : vigilance et info = nos meilleurs alliés. Facile à dire mais pas toujours à appliquer… 😉
Petite faute dans mon contrat : ils disent juste « prise en charge partielle », mais jamais précisé combien. C’est normal ça ?
Pfff encore un exemple qui montre que le « droit du travail » protège pas tant que ça…
Sérieux, 48 minutes par jour c’est énorme quand on calcule à l’année ! 😮
Il y a tellement de subtilités que sans syndicat, impossible de s’y retrouver…
Est-ce que quelqu’un a déjà gagné aux prud’hommes sur ce sujet ?
Merci bcp pour ces infos claires. Je vais partager ça avec mes collègues. 👍
C’est vraiment légal de ne pas payer alors qu’on est en déplacement pro ?? Ça me choque.
Intéressant de savoir qu’en sécurité privée, le temps est payé dès qu’on part du local. Je vais vérifier mon contrat.
Mdr donc si j’appuie sur un bouton « vie privée » je ne suis plus surveillé ? Quelle blague 😂
Toujours les mêmes qui trinquent… Les patrons trouvent des « astuces », et nous on subit.
Quand on dit « trajet exceptionnel », ça veut dire quoi exactement ? Genre une mission ponctuelle dans une autre ville ?
Je croyais que dans le BTP c’était normal que le matin soit pour l’ouvrier et le soir pour l’employeur. Apparemment c’est faux ? 🤔
Donc en gros, faut tout noter et garder des preuves sinon l’employeur nie tout…
Un peu technique comme sujet mais super utile, merci !
C’est dingue comme les entreprises arrivent toujours à détourner les règles…
Question : est-ce que le trajet entre deux clients dans la même journée est payé ?
Franchement c’est abusé… On parle de presque 2000€ perdus par an ! 😡
Merci pour l’article, ça m’a permis de voir que ma convention collective prévoit en fait une indemnité.
Je comprends pas, si on est obligé d’aller sur un chantier à 100km, ça compte pas comme du boulot ?
Encore une astuce pour gratter sur le dos des salariés… ça devient lassant !