Dans cet article Dans cet article
Les compagnies d’assurance appliquent régulièrement une décote sur la valeur des biens endommagés, appelée clause de vétusté, même lorsque l’assuré n’est pas responsable du sinistre et cette pratique suscite depuis plusieurs années des contestations croissantes face à une indemnisation jugée trop faible.
La clause de vétusté, un mécanisme méconnu
La vétusté consiste à calculer une perte de valeur liée au temps et à l’usage. Lorsqu’un appareil électroménager ou un meuble est détruit par un sinistre, l’indemnisation ne couvre pas toujours son remplacement neuf. Dans certains cas, elle est amputée d’un pourcentage considérable.
D’après les chiffres communiqués par plusieurs associations de consommateurs, jusqu’à 40 % des litiges liés aux indemnisations concernent cette décote. Les assurés dénoncent une double peine : subir un dommage sans faute puis assumer une perte économique supplémentaire.
Un témoignage révélateur
« J’ai eu un dégât des eaux chez moi, causé par l’appartement du dessus. L’assurance m’a indemnisée mais avec 30 % de retenue pour vétusté sur mes meubles alors que je n’y étais pour rien », raconte Sylvie, 46 ans, propriétaire à Lyon.
C’est en parlant avec son courtier qu’elle découvre une méthode simple qui aurait pu changer le montant de son indemnisation. Une démarche que peu d’assurés connaissent encore mais qui fait toute la différence face aux experts mandatés par les compagnies.
L’astuce méconnue : la déclaration photo
Avant tout sinistre, il est possible d’établir une preuve claire et datée de l’état et de la valeur de ses biens grâce à une série de photos accompagnées d’une déclaration envoyée à son assureur. Ce document ne nécessite aucune expertise particulière mais permet de figer la situation matérielle.
- Photographier chaque pièce et chaque bien significatif (meubles, appareils électroménagers, équipements électroniques).
- Joindre si possible les factures ou garanties lors du premier envoi.
- Adresser le tout par mail ou courrier recommandé afin que l’assureur enregistre officiellement ces éléments au dossier.
Ces clichés deviennent alors une preuve incontestable en cas de sinistre. Ils permettent d’opposer aux experts une référence tangible sur l’état réel du bien avant sa dégradation et donc de limiter ou annuler la décote liée à la vétusté lorsqu’on n’est pas responsable du dommage.
L’impact concret sur l’indemnisation
Sans ces preuves visuelles intégrées au dossier initial, l’expert applique souvent des barèmes standardisés qui réduisent fortement le montant remboursé. En revanche, lorsque des photos récentes sont disponibles et validées par l’assureur avant tout incident, il devient difficile pour lui d’imposer une dépréciation arbitraire.
| Situation | Indemnisation sans photos | Indemnisation avec déclaration photo |
|---|---|---|
| Téléviseur acheté il y a 4 ans | -40 % selon barème vétusté | Valeur proche du remplacement neuf prouvée par état correct |
| Sofa en tissu entretenu | -25 % appliqué automatiquement | Aucune décote grâce à preuve photographique récente |
| Réfrigérateur récent | -20 % sur facture initiale estimée obsolète | Indemnisé valeur d’achat grâce aux justificatifs joints aux photos |
Un geste simple qui change les rapports avec l’assureur
Loin d’être une formalité administrative inutile, cette démarche place l’assuré dans une position plus équilibrée face aux règles strictes des contrats. Certains professionnels affirment que cette pratique réduit nettement les litiges et accélère même le traitement des dossiers indemnitaires.
« Si j’avais su avant, j’aurais pris dix minutes pour photographier mes biens. Aujourd’hui je le fais régulièrement et j’ai même transmis le dossier complet à mon assureur », ajoute Sylvie.
L’expérience montre que cette initiative contribue à rétablir une forme d’équité dans le rapport entre particuliers et compagnies. Elle invite aussi chacun à anticiper plutôt qu’à subir. Beaucoup ignorent encore cette possibilité alors qu’elle pourrait devenir un réflexe aussi banal que conserver ses factures.
Vers un changement des pratiques ?
Certaines associations militent désormais pour rendre obligatoire ce type de procédure afin de protéger davantage les assurés non responsables. Les assureurs restent prudents mais reconnaissent que la photographie horodatée simplifie leurs propres expertises. La question reste ouverte : faut-il laisser cette responsabilité uniquement au consommateur ou instaurer un cadre plus contraignant ? Voilà un débat qui ne manquera pas d’agiter autant les couloirs des compagnies que ceux des assemblées citoyennes.



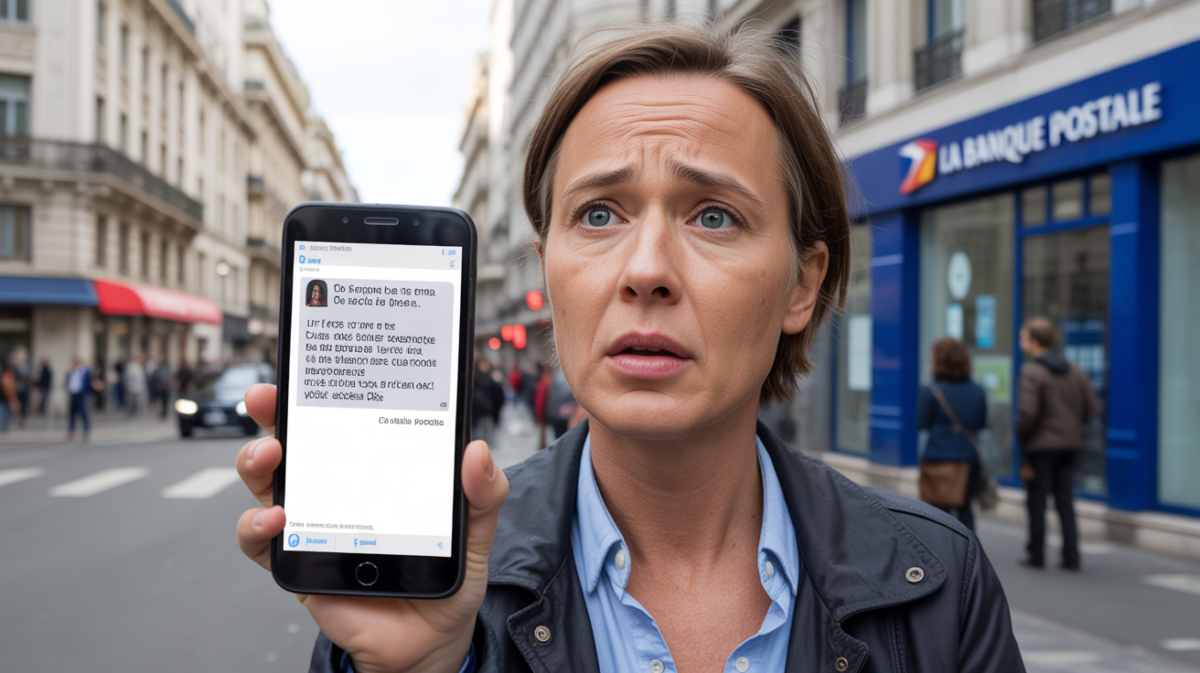

Sérieusement qui garde toutes ses factures + prend des photos de tous ses meubles ??
Bizarre quand même… pourquoi les associations de consommateurs n’en parlent pas plus ?
Merci beaucoup, super article utile. 😊
A tester… mais j’ai peur que mon assureur ignore mes photos 🤔
Ça me semble être du bon sens, étonnant que ce ne soit pas déjà obligatoire.
Est-ce qu’une vidéo peut aussi fonctionner ou uniquement des photos horodatées ?
Mdr donc il faut devenir photographe amateur pour être bien assuré 😂
C’est légalement contraignant pour l’assureur ? Ou juste indicatif ?
Encore un truc administratif en plus… mais bon si ça évite de perdre 30%, ça vaut le coup.
Super simple comme conseil et logique en fait ! Je vais m’y mettre direct 😃
Trop long à faire… je parie que 90% des gens vont jamais s’y mettre.
C’est pas un peu lourd d’envoyer toutes ces photos par courrier recommandé ?
Merci infiniment pour l’astuce, j’aurais voulu savoir ça avant mon dégât des eaux…
Bonne info, mais est-ce vraiment accepté par toutes les assurances ?
Je trouve ça triste qu’on doive en arriver à se prémunir contre son propre assureur 😕
Article très clair, ça donne envie de se protéger davantage.
C’est fou que ce ne soit pas plus connu !
Je vais faire ça ce week end, merci pour l’idée 👍
Un peu sceptique… les assureurs trouveront toujours une faille pour appliquer la vétusté.
Est-ce que ça marche aussi pour une voiture ou seulement pour l’habitation ?
Encore une combine pour se protéger des compagnies d’assurances… on marche sur la tête.
Donc si je comprends bien, il suffit de prendre des photos et les envoyer à l’assureur ? Simple mais malin !
Très intéressant, je ne connaissais pas du tout cette astuce ! Merci pour le partage.